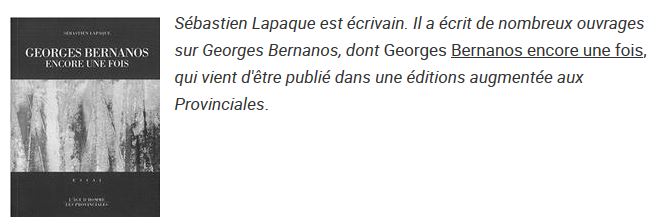FIGAROVOX/TRIBUNE – Georges Bernanos est décédé le 5 juillet 1948. Pour les 70 ans de l’anniversaire de sa mort l’écrivian Sébastien Lapaque a prononcé un discours d’hommage sur sa tombe à Pellevoisin (Indre). En voici la retranscription.
Il y a trois décennies, après la Palme d’or du festival de Cannes attribuée à Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, lorsque l’on évoquait le nom de Georges Bernanos, l’on songeait à ses romans. L’abbé Donissan avait le visage de Gérard Depardieu, Mouchette celui de Sandrine Bonnaire. Le cinéma a beaucoup fait pour le rayonnement de l’œuvre de Bernanos. Auparavant, il y avait eu Journal d’un curé de campagne, en 1951, et Mouchette, en 1967, deux chefs d’oeuvre de Robert Bresson. D’une époque à l’autre, ces films, auxquels il faut ajouter l’opéra de Francis Poulenc tiré de Dialogues des Carmélites en 1957, ont sans cesse fait entendre la voix de Georges Bernanos à de nouveaux lecteurs. Mieux que les manuels scolaires et l’eau bénite servie dans les collèges. Catholique errant et royaliste flamboyant, adversaire de la démocratie qu’il regardait comme «la forme politique du capitalisme», l’auteur de Scandale de la vérité n’a jamais été un écrivain conseillé par l’école de la République. La place accordée dans ses romans à la vanité des satisfactions bourgeoise (L’Imposture, La Joie), à la religion dégénérée (Monsieur Ouine), au meurtre (Un crime) et au sexe (Sous le soleil de Satan, Nouvelle histoire de Mouchette) n’en fait pas non plus un auteur très en vogue dans l’enseignement privé.
N’importe. «Puissions-nous toujours ensemble moi et mes livres être à la merci des passants!» demande l’écrivain dans Les Enfants humiliés, son journal des années 1939-1940 rédigé à Pirapora, dans les profondeurs de l’immense Brésil. Le vœu est exaucé. Son œuvre n’appartient ni à la gauche, ni à la droite ; on trouve, parmi ses lecteurs, des gens qui croient au Ciel et d’autres qui n’y croient pas. Chacun est libre d’y entrer selon son humeur et sa tradition. Aujourd’hui, on observe une nouvelle génération de lecteurs pour laquelle Georges Bernanos, c’est d’abord La France contre les robots et La liberté pour quoi faire?, puissants cris de colère contre l’anéantissement de la liberté individuelle par la Technique, le contrôle des existences, le nivellement totalitaire du monde et la «décoloration des consciences» subséquente.
Bernanos fait partie des écrivains qui ont critiqué les formes de vie barbares indifférentes aux valeurs de la culture provoquées par les excès néfastes d’un capitalisme effréné et prédateur.
Jadis rangé sur la même étagère que François Mauriac et Jacques Maritain, l’auteur de Français, si vous saviez se trouve associé à George Orwell, Günther Anders, Pier Paolo Pasolini et Jacques Ellul — des écrivains qui ont critiqué les formes de vie barbares indifférentes aux valeurs de la culture provoquées par les excès néfastes d’un capitalisme effréné et prédateur.
Le rapprochement entre ces écrivains inclassables est moins incongru qu’on ne le croit. Contraint, par la brutalité des événements, à abandonner son œuvre romanesque après avoir achevé Monsieur Ouine en mai 1940, Georges Bernanos s’est intéressé à Jacques Ellul, l’analyste implacable du Système technicien et du Bluff technologique évoqué dans une conférence des années 1946-1947 reprise dans La liberté pour quoi faire? «J’ai lu le compte rendu d’une séance donnée par le Centre protestant d’études, au cours de laquelle le professeur Jacques Ellul traçait un remarquable tableau du monde moderne et de toutes les emprises de l’Économie sur l’homme (…) L’homme, selon l’éminent professeur, n’est plus en face de l’économie, son autonomie est en train de disparaître, il est englobé corps et âme dans l’économie, c’est l’apparition réelle d’une nouvelle espèce d’homme, l’homme économique, l’homme (…) qui n’a pas de prochain mais des choses.» Avec un peu d’avance sur son temps, et même beaucoup, Georges Bernanos a ainsi pris place parmi les esprits désolés qui ont dénoncé l’expansion des forces productives et l’accumulation du capital, conscients du fait qu’on ne peut pas croître de manière infinie dans un monde fini, sauf dans la douce pitié de Dieu.
La France contre les robots a paru au Brésil en 1946 et l’année suivante en France. Dans ce chef d’oeuvre terminal dont l’importance capitale ne nous apparaît qu’aujourd’hui, l’écrivain aux puissants dons de visionnaires ne propose pas simplement des clés pour critiquer et liquider le mythe de la techno-science-économie. Il nous offre des pistes pour une véritable insurrection de l’esprit, un soulèvement de la vie, en contestant l’analyse platement matérialiste et mécaniste de la société hédoniste et du bonheur laïque. «On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Hélas! la liberté n’est pourtant qu’en vous, imbéciles!»
Soixante-dix ans après la mort de Georges Bernanos, le lundi 5 juillet 1948 à l’Hôpital américain de Neuilly, on est frappé de découvrir à quel point les textes qu’il nous a laissés sont vivants, à quel point ils éclairent les événements que nous sommes en train de vivre. Depuis les dernières pages de La Grande peur des bien-pensants, publiée en 1931, jusqu’à son Encyclique aux Français, ébauchée à la veille de sa mort, en mai 1948 et laissée inachevée, Bernanos est sans cesse prophétique. Il ne devine pas l’avenir, il est dans la vérité. Car le dit du prophète n’est pas la prédiction de l’avenir, comme on le croit souvent, c’est la parole je-tée en avant. Le prophète, c’est celui qui parle quand les autres se taisent.
Soixante-dix ans après la mort de Georges Bernanos, on est frappé de découvrir à quel point les textes qu’il nous a laissés sont vivants.
«Le premier devoir d’un écrivain est d’écrire ce qu’il pense, coûte que coûte. Ceux qui préfèrent mentir n’ont qu’à choisir un autre métier — celui de politicien, par exemple. Ecrire ce qu’on pense ne signifie nullement écrire sans réflexion ni scrupule tout ce qui vous passe par la tête. Ceux qui me connaissent savent parfaitement que je ne suis que trop disposé aux discussions avec moi-même. Je dîne rarement en ville, je ne vais jamais au casino, presque jamais au cinéma ; que voudrait-on que je fasse, au cours de ces longues journées passées tout entières en face d’un pauvre petit cahier d’écolier, sinon peser interminablement le pour et le contre? Je ne suis pas Don Quichotte, je n’éprouverais aucun plaisir à me battre contre les moulins à vent. Il m’en coûte beaucoup plus qu’on croit de prendre position, de grossir ainsi le nombre d’ennemis que j’ai dans le monde, ou — ce qui revient au même — d’approfondir et d’élargir ma solitude. Je commence à vieillir, je voudrais bien me préparer d’avance à mourir tranquille, mais j’écris sans illusion, je n’ai jamais vécu tranquille, et je ne mourrai pas tranquille.»
Lu au bord de la tombe de Georges Bernanos, cet article paru dans O Jornal à Rio de Janeiro en février 1945 et repris dans Le Chemin de la Croix des Ames a quelque chose de bouleversant. «Je ne mourrai pas tranquille». L’abbé Pézeril, son confesseur, a raconté les derniers jours de Georges Bernanos et son entrée dans la Sainte Agonie après celle de tant de ses personnages, l’abbé Chevance dans L’Imposture, son cher curé d’Ambricourt, la Prieure dans Dialogues des Carmélites. Atteint d’un cancer du foie détecté à un stade avancé, opéré le 20 juin par le professeur François de Gaudart d’Allaines, l’écrivain entré dans la salle d’opération en chantant la Marseillaise se savait condamné depuis quelque temps déjà.
À la date du 24 et 25 janvier 1948, il avait laissé dans son agenda un texte qui ressemble à une prière. «Nous voulons vraiment ce qu’Il veut, nous voulons vraiment, sans le savoir, nos peines, nos souffrances, notre solitude, alors que nous nous imaginons seulement vouloir nos plaisirs. Nous nous imaginons redouter notre mort et la fuir, quand nous voulons réellement cette mort comme Il a voulu la Sienne, notre mort est d’ailleurs la Sienne. De la même manière qu’il se sacrifie sur chaque autel où se célèbre la Messe, il recommence à mourir dans chaque homme à l’agonie. Nous voulons tout ce qu’Il veut, mais nous ne savons pas que nous le voulons nous ne nous connaissons pas, le péché nous fait vivre à la surface de nous-mêmes, nous ne rentrons en nous que pour mourir et c’est là qu’Il nous attend».
La mort de Georges Bernanos fut moins intranquille qu’il ne l’avait annoncé. Peu avant minuit, le dimanche 4 juillet, sentant qu’il allait prendre congé des siens, il s’est écrié: «A nous deux» — un défi fameux. Mais son agonie s’est prolongée. L’abbé Pézeril a rapporté qu’il était mort à l’aube. «Vers 5 heures, du pied de son lit, je vois son visage qui s’attendrit et remue, ses yeux s’ouvrent. Mme [Jeanne] Bernanos s’approche. Il vide à tous petits coups le bol de souffle qui lui reste dans la poitrine. Il dit très distinctement: «Jeanne… Jeanne… Jeanne» (…) Chacun des siens l’embrasse, sa femme penche le visage contre son visage, il serre sa tête, à elle, contre soi. Mme Bernanos récite un Notre Père, un Je vous salue Marie. Il bouge les lèvres. Puis il reprend: «Jeanne» (…) Sans qu’aucun pli de son visage n’ait remué, les yeux doucement clos, il est mort.»*
Ce dernier mot sonne étrangement, pour nous qui sommes réunis sur la tombe de Georges Bernanos, ce jeudi 5 juillet 2018, et qui avons du mal à croire entièrement à la mort: nous n’y croyons pas tout à fait et nous n’y croyons même pas du tout. Qui ne voit pas, aujourd’hui, que l’auteur de La Joie est bien plus vivant que la plupart des vivants? Dans le tome II des Essais et écrits de combats publié par la Bibliothèque de la Pléiade en 1995, nous redécouvrons aujourd’hui toute une partie de son oeuvre que nous avions mal lue, ou pas lue du tout. Ainsi Lettre aux Anglais et Le Chemin de la Croix des Ames, deux textes incandescents inspirés par son d’exil mélancolique au Brésil, entre 1938 et 1945. Avec lucidité, l’écrivain y dénonce l’ordre dégradant de la horde et le saccage de toutes les valeurs. Hélas, cela pas pris fin avec la chute du nazisme. Cet ordre et ce saccage nous mena-cent tandis que notre pays «est en train de se vider du spirituel».
Le village de Pellevoisin a la chance d’être protégé par Marie, Reine du Ciel, celle qui a gardé la foi le Samedi Saint. Mais que penser de toutes les «paroisses mortes» aux alentours, dans le grand nulle part géographique et spirituel que la Déléga-tion interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) nomme sans humour la diagonale du vide? La Paroisse morte, on le sait, est le titre que Bernanos avait d’abord choisi pour ce qui allait devenir Monsieur Ouine, tragique et prophétique tableau d’un pays dépourvu de vie, d’un pays étrangement possédé non par la violence mais par le néant. «Je suis vide, moi aussi», dit Monsieur Ouine dans le roman. Et plus loin: «Je me vois maintenant jusqu’au fond, rien n’arrête ma vue, aucun obstacle. Il n’y a rien. Retenez ce mot: rien!»
Georges Bernanos éclaire notre présent dans un pays toujours exposé à être trahi par ses élites, partant à retomber dans la médiocrité et à décevoir les espoirs.
L’ultime métaphore romanesque de Georges Bernanos nous décrit ainsi en otages du néant, âmes mortes d’une paroisse morte. De retour en Europe en juin 1945, il a compris qu’il ne s’était pas trompé, effrayé par l’effondrement de la civilisation européenne provoqué par la guerre totale. Dans cet effondrement, l’écrivain qui avait sacrifié au préjugé antisémite dans La Grande peur des bien pensants n’a pas négligé l’oeuvre de mort accomplie sur les juifs et sans cesse recommencée aujourd’hui. Terrifié par le souffle nucléaire du nazisme au tréfonds des consciences, il a entrevu, dans La France contre les robots, ce que le philosophe Jean-Claude Milner a nommé «les penchants criminels de l’Europe démocratique».
On ne peut donc pas s’étonner d’entendre aujourd’hui un homme tel que Georges Bensoussan, historien du sionisme et de la Shoah, évoquer le dégoût éprouvé par l’écrivain dans une France infidèle à son histoire et à sa vocation. «Je comprends mieux aujourd’hui l’exil volontaire de Bernanos en 1938. À un certain stade de veulerie, la tentation de l’exil s’offre comme un salut», confiait-il voici quelque temps. C’est ainsi, rebelle aux lois de la démocratie et à l’esprit du temps, que Georges Bernanos éclaire notre présent dans un pays toujours exposé à être trahi par ses élites, partant à retomber dans la médiocrité et à décevoir les espoirs.
Fuente: www.lefigaro.fr